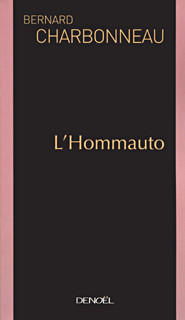Version imprimable de l’Avis au conducteur
Bernard Charbonneau
Avis au conducteur
(Préface à L’Hommauto, 1967)
Au mort inconnu de la seconde tuerie motorisée
Stop ! Voie sans issue. Demi-tour ! Le temps n’est plus où les civilisations se définissaient par le Christ ou la Liberté. Aujourd’hui, les religions, heureusement réduites à l’esprit, n’ont aucune action sur les mœurs ni sur la politique et les idéologies sont en crise. Ce n’est plus un Dieu, ni même un principe, qui préside à notre société, mais un fait : une machine, ce gros cafard aux yeux fixes, l’automobile, ainsi nommée parce qu’elle se meut d’elle-même. À 150, elle fonce droit au but, vers l’avenir. Lequel ? Nul ne sait.
Si quelque Sénélite découvrait l’Europe ou l’Amérique, il définirait leur civilisation comme celle de l’automobile. Elle est notre idéal ; chaque automne nous allons l’adorer devant l’autel où elle brille de mille feux. Et elle hante nos rues comme nos rêves. L’économie de la France ou des USA est, pour une bonne part, une économie de la bagnole ; que Ford ou Renault vende mal, ou que leur production décline, la crise, le chômage et la Révolution menacent le pays : c’est Volkswagen qui a probablement sauvé jusqu’ici l’Allemagne de l’Ouest d’Hitler. Que la crue de la matière à roues monte toujours plus vite, la prospérité règne, et la foi dans l’avenir. L’auto envahit le temps : d’après Gallup, les Américains passeraient 18,22 % de leur journée dans leur voiture. Et elle façonne l’espace ; elle déblaie dans le tissu des maisons le vide cimenté nécessaire à sa ruée ou à son repos. Car il lui faut non seulement des voies de plus en plus larges, mais un logement ; on pourrait dire : une autre cité et un autre citoyen.
Il est d’ailleurs peut-être en train. L’homme occidental tend à faire corps avec sa bagnole ; sans roues il n’est plus qu’un misérable homme-tronc : un piéton. Ou plutôt, impatiente au bord du trottoir, la bagnole attend son homme ; car il faut bien que lui aussi regagne son garage, c’est-à-dire sa maison. L’hommauto forme un tout dans sa coquille à moteur. Il va, l’auto l’avale, la portière claque et il démarre. Il vient et, après un dernier rot, la bagnole accouche de la personne humaine ; mais elle la récupère bientôt. Contact, l’auto ronronne ; il fallait l’homme pour lui donner la vie. Il la conduit, mais désormais c’est l’engin qui l’entraîne. Quand l’invincible mécanique fonce en jetant sa clameur, qui se douterait qu’elle renferme un délicat mammifère que le moindre choc suffit à meurtrir ? Il faut qu’un accident vienne la broyer pour qu’un filet de sang filtrant à travers les tôles nous fasse découvrir qu’elle dissimulait un corps, et peut-être une âme.
L’auto-mobile commande ; c’est le poids de l’univers et de la société qui nous cale les fesses sur son siège. Nous vivons en bagnole ; nous y roulons sur des autoroutes, nous y mangeons dans des restauroutes ; nous y dormons, nous y faisons l’amour ; et nous y mourons. Toute divinité exige sacrifice, et la belle déesse lève un tribut qui est à la mesure de son prestige et de sa puissance. Elle prélève sa dîme ou son quint sur le budget de la ville et le salaire du travailleur ; pour lui permettre de courir après l’ombre de la nature et de la liberté, en retrouvant finalement au bout de sa course la foule et le bruit qu’il avait fuis : l’automobile. Et tout sacrifice est sanglant. Chaque année plus de dix mille morts et deux cent mille blessés tombent en France dans la tentative de percée du week-end – sans compter les ruines matérielles, qui ne sont pas toutes remboursées par le tribut, toujours plus draconien, prélevé par les assurances. Pas un Français qui n’ait frôlé la mort, qui ne soit un jour atteint dans sa chair ou ses affections. Mais qu’importent ses morts à l’offensive ensoleillée qui se rue vers les plages ! Parfois des uniformes noirs et un drap blanc sur l’asphalte stoppent notre élan ; il faut bien vivre et progresser, et nous écrasons l’accélérateur. C’est le grand départ vers l’Éden, Français, en voiture ! Votre cercueil vous attend ; l’enterrement du pauvre dans les tôles minces d’une 2CV, ou celui du riche dans les crocs d’acier d’une Jaguar.
Désormais nous pouvons foncer ; il suffit d’une imperceptible pression. Seulement, vers quoi ? Et comment ? Nous avons une auto, il nous reste à nous en servir. Mais pour que le chauffeur reprenne ainsi le volant, il faut qu’il aille à rebours de sa pente, qui est de laisser faire la machine. Certains diront : si la banquise à moteur bloque les villes, il n’y a qu’à bâtir la ville des autos, sinon des humains. Et si la bagnole tue, c’est la faute à la route, ou mieux encore au conducteur ; il suffira de le doter d’un troisième œil, et d’une autre conscience. Après tout, la R16 a bien succédé à la De Dion, pourquoi pas Superman à Dupont ?
Mais comme l’hommauto forme un tout, je crains qu’il ne faille à la fois changer la carrosserie et le moteur : la bagnole avec son chauffeur. Si celui-ci change d’esprit, je ne doute pas qu’il ne change de corps : de voiture. S’il n’est plus l’esclave, mais le maître de sa vitesse, comme l’y invite le code, il réclamera un engin plus sûr, même s’il est moins rapide ; il lui demandera de le mener quelque part : au bord de la Marne et non du Styx. L’important c’est la fin, non le moyen, du transport ; plutôt que notre auto, là où elle s’arrête.
Comme au premier jour, c’est à l’homme de faire l’essentiel du parcours, en se servant de ses muscles et de ses méninges. Nous y sommes. Stoppons ; coupons le contact. La nuit explose, et l’immensité. Ouvrons la portière et naissons à notre corps : marchons. On ne pénètre pas à cheval dans sa maison.
Bernard Charbonneau, L’Hommauto.
Denoël, 1967, rééd. 2003